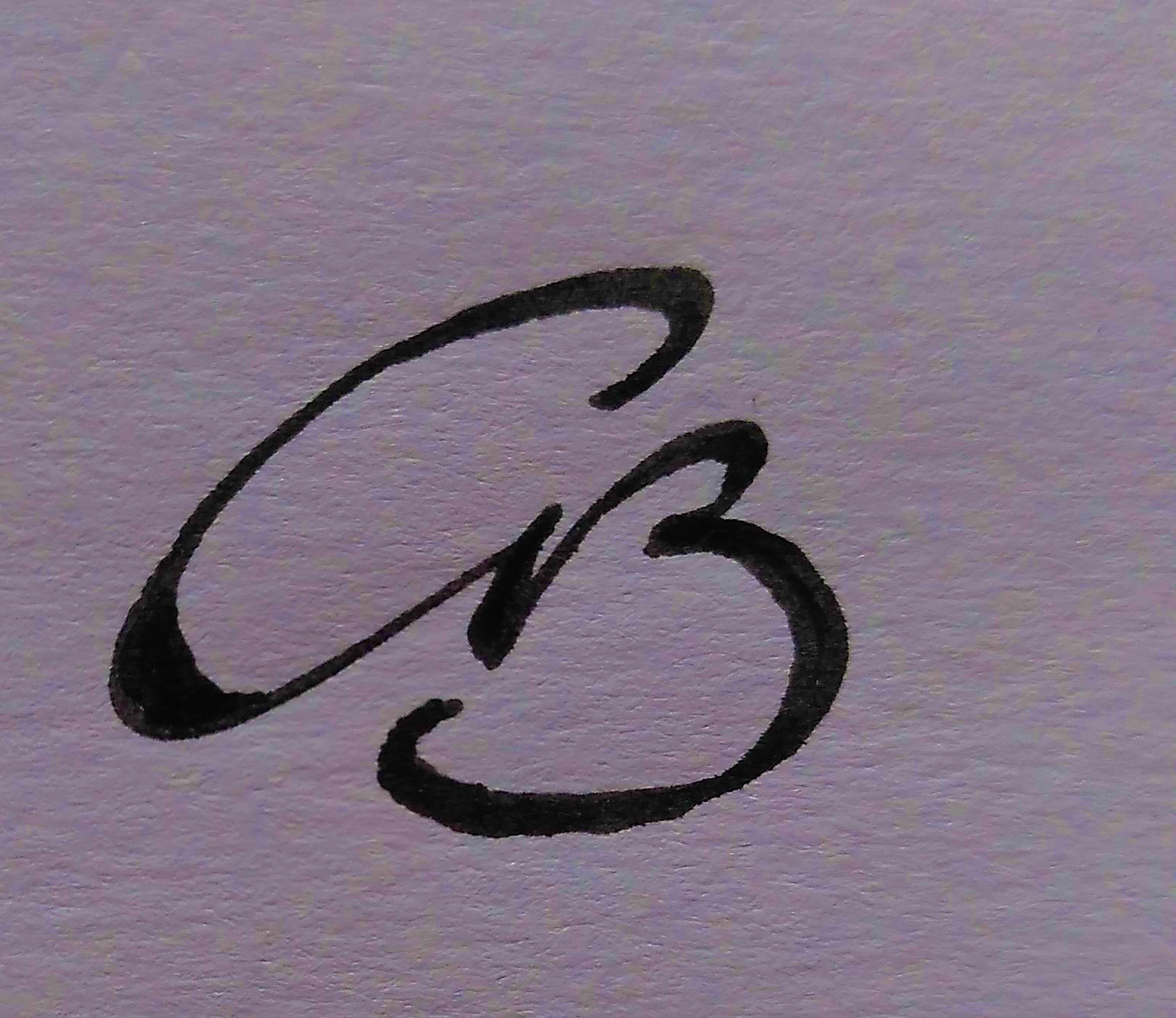1992
De Yukio Mishima, version française d’André Pierre de Mandiargues
Mise en scène Philippe Macaigne assisté d’Edouard Montoute, scénographie Xavier Quienne, son Marc Bretonniere, lumières Laurent de La Rosa
Avec Cécile Brune, Muriel Gorius, Muriel Solvay, Agnès Bove, Nathalie Hugon
Spectacle de l’Argonaute avec la participation du Jeune Théâtre National et le soutien de la fondation du Japon
(La Métaphore) Théâtre de l’Idéal, Tourcoing
Faut-il croire Mishima lorsqu’il écrit que sa pièce pourrait être intitulée : »Sade u à travers le regard des femmes « ? Les six femmes qui entourent le marquis ont fondé leur comportement sur l’idée, terrible ou séduisante, qu’elles se font de lui. Mais, parce que son absence et son souvenir ne leur ouvrent pas d’horizon, il ne reste à chacune que sa solitude et sa raison inquiète. Seule la marquise, madame de Sade, refusant aussi bien le pardon aveugle que la simple condamnation, cherche à comprendre réellement l’homme qu’il est. Au bout de sa recherche, croyant le saisir, c’est elle-même qu’elle atteindra. Car l’innommable n’est-il pas en fait celui qui permet à chacun, à chacune, de se nommer enfin ?
Philippe Macaigne
Yukio Mishima est l’un des plus grands écrivains japonais du XXeme siècle. Fortement attaché aux traditions ancestrales de son pays, notamment celles des « samouraîs », il est l’auteur de romans, de nouvelles et de « nôs » modernes. Il se suicida par seppuku (« hara kiri »)public en 1970.
Madame de Sade se construit comme autour d’une énigme : comment la marquise de Sade, qui avait montré tant de fidélité à son mari pendant ses longues années d’emprisonnement, a-t-elle pu l’abandonner au moment même où il retrouvait la liberté ?
Philippe Macaigne est né en 1965, il quitte le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en juin 1992. Il y a suivi les cours de Georges Werler, Stuart SIde et Daniel Mesguich. Madame de Sade est sa première mise en scène.
Ce qui est du moins acquis à la science, c’est que depuis ce temps, l’homme, à la figure de crapaud, ne se reconnaît plus lui-même, et tombe souvent dans des accès de fureur qui le font ressembler à une bête des bois. Dans tous ces temps, il avait cru, les paupières ployant sous les résidus de la modestie, qu’il n’était composé que de bien et d’une quantité minime de mal. Brusquement je lui ai appris, en découvrant au plein jour son cœur et ses trames, qu’au contraire il n’est composé que de mal, et d’une quantité minime de bien que les législateurs ont bien du mal a ne pas laisser évaporer.
Lautréamont